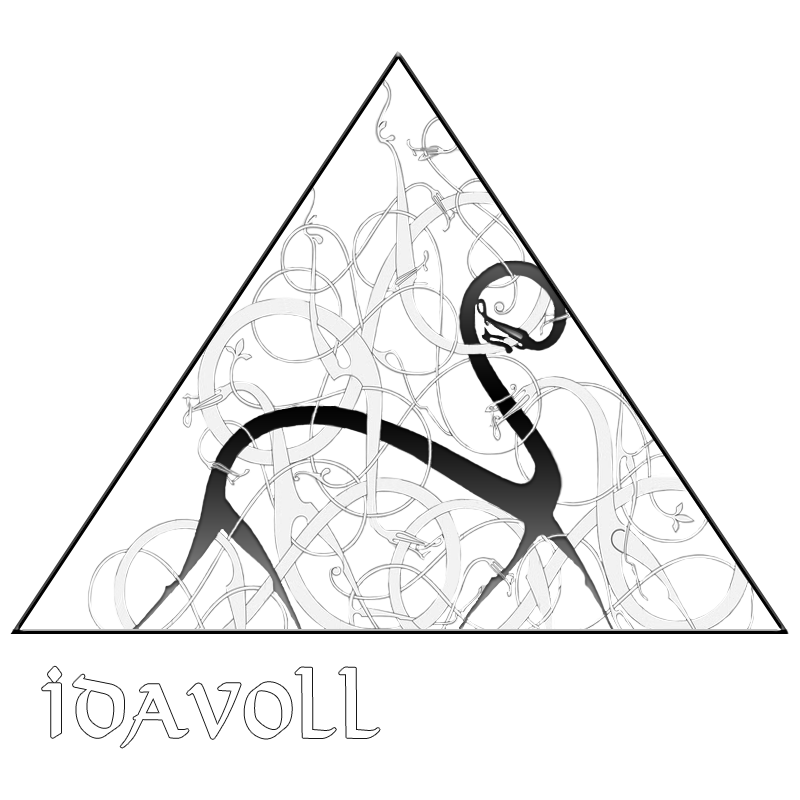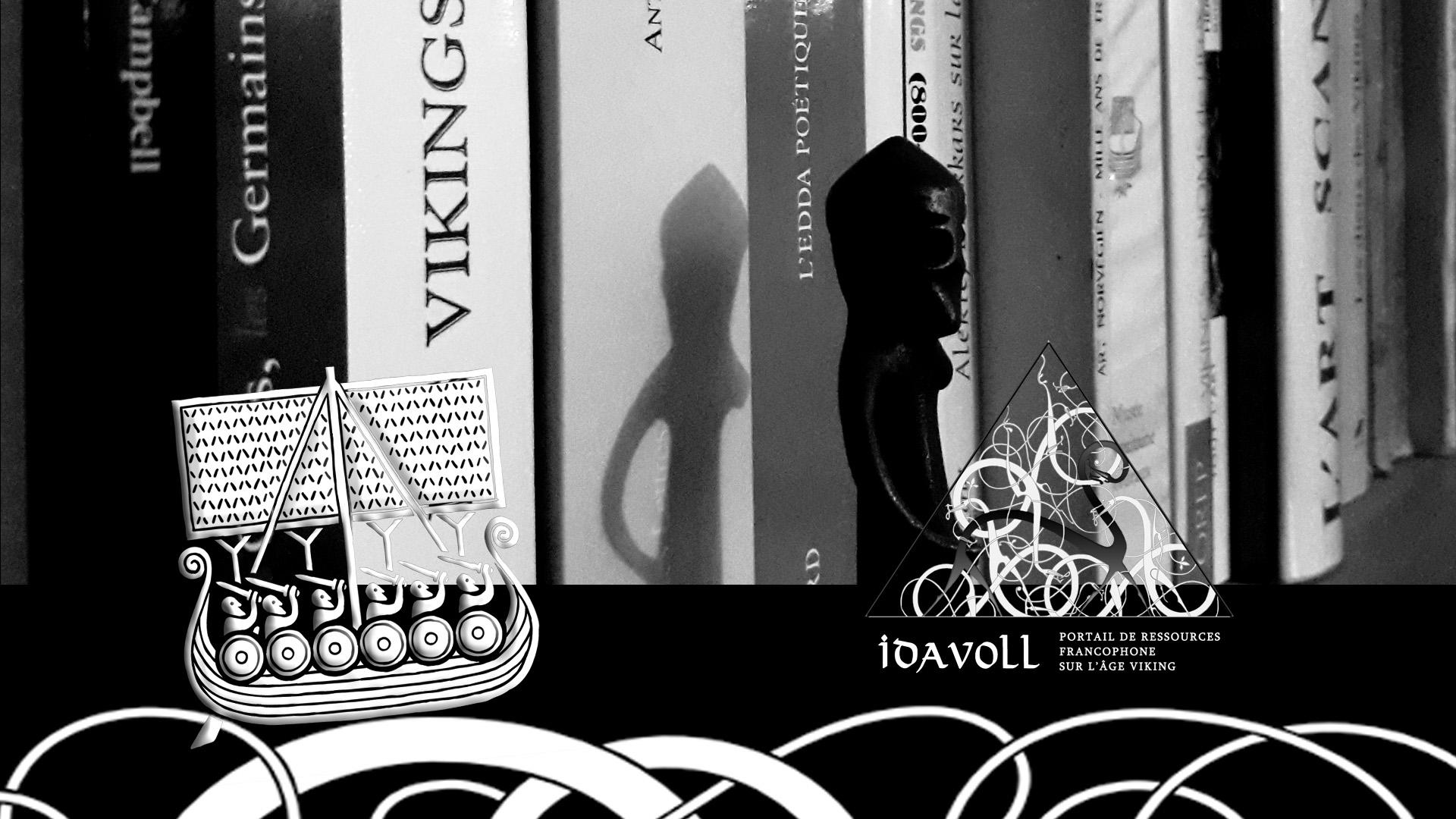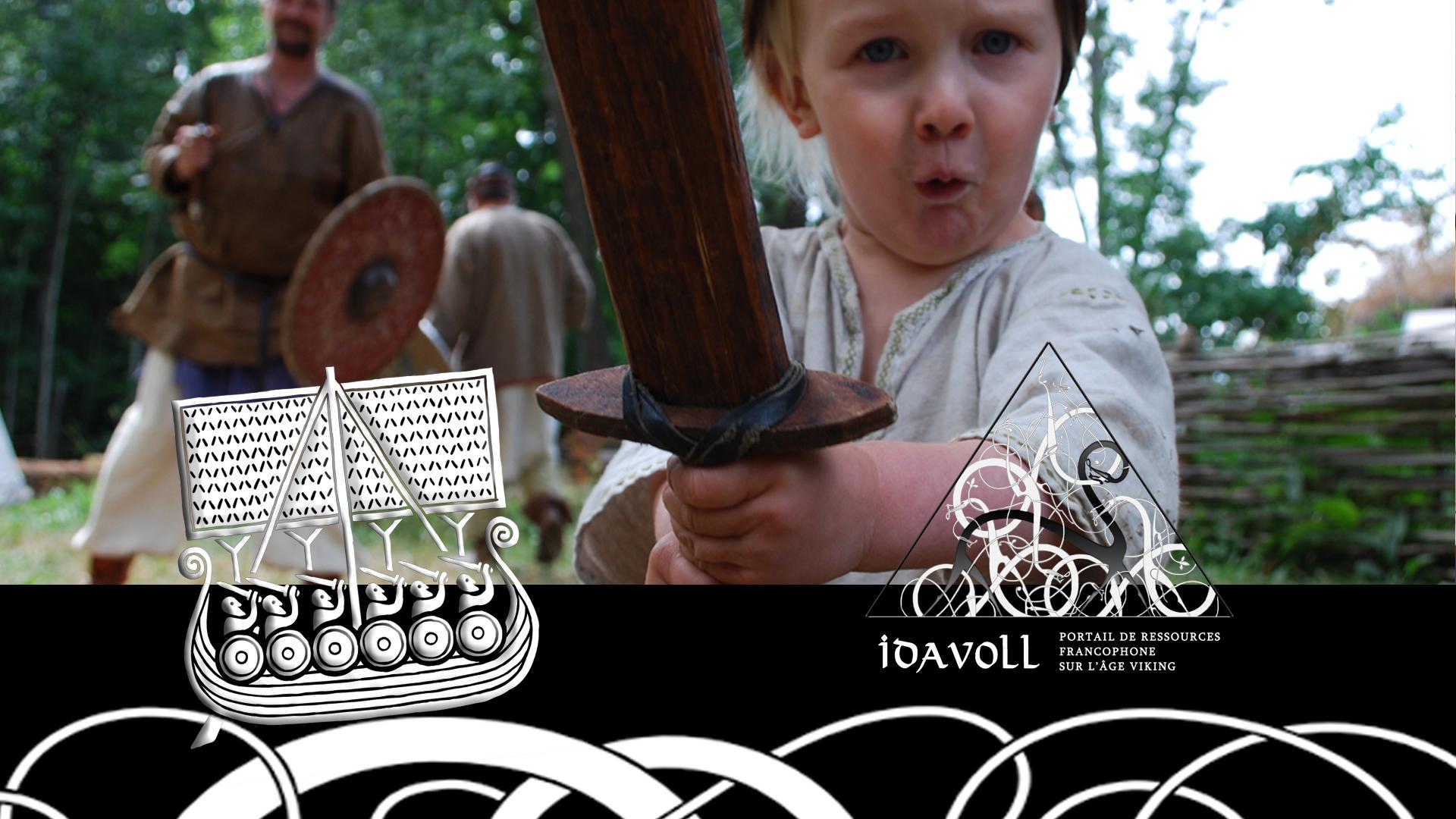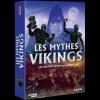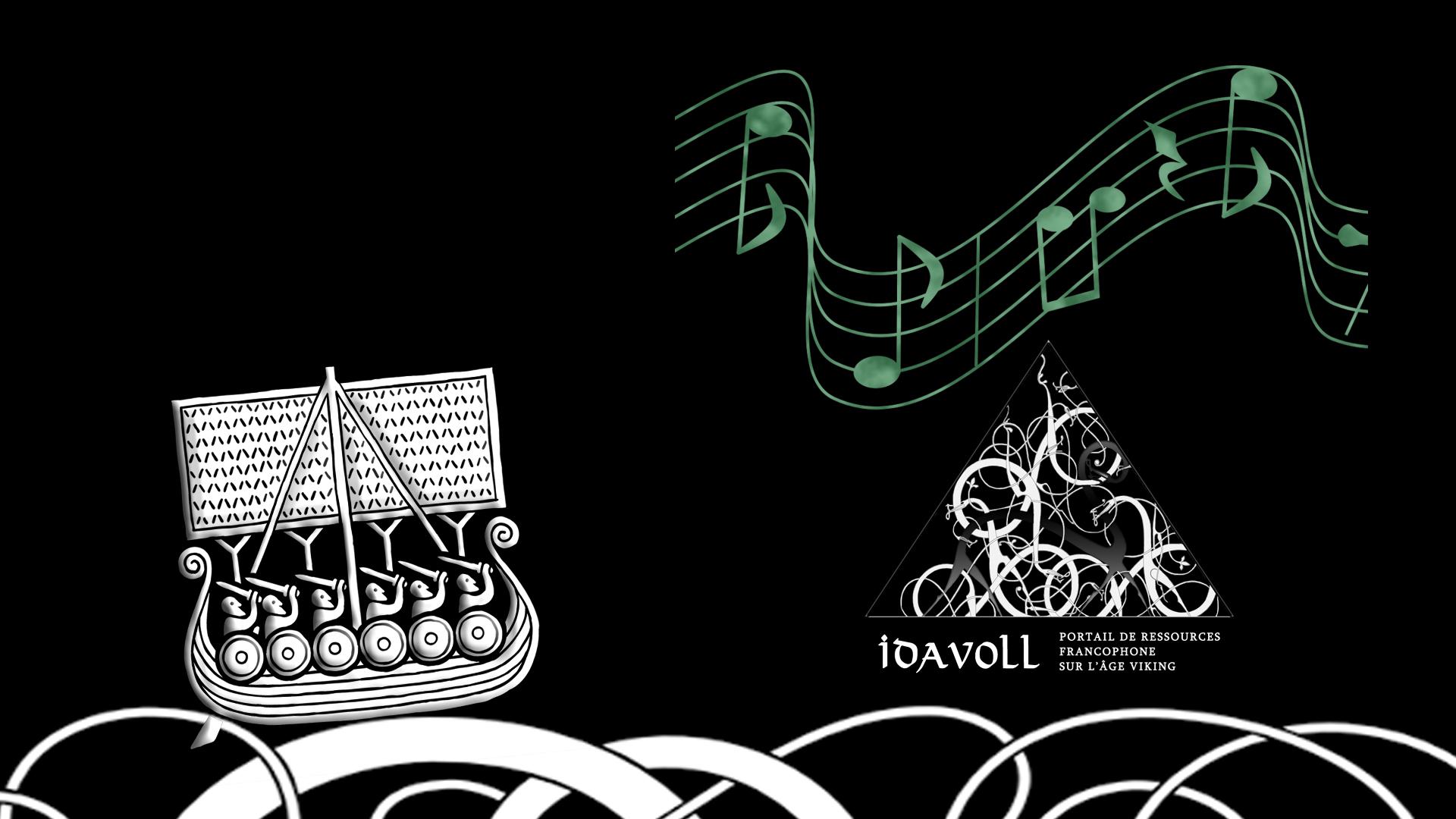Angleterre - La plus grande halle viking de Grande-Bretagne découverte dans le comté de Cumbria
- Le 17/02/2025
- Dans Archéologie
- 0 commentaire
En cherchant les vestiges d'une ferme monastique sur les terres de l'abbaye voisine, près du village de Holme St Cuthbert, dans le comté de Cumbria, les archéologues ont mis au jour les traces d'un bâtiment en bois de l'Âge Viking. Il s'agirait de la plus grande halle de type scandinave jamais découverte en Grande-Bretagne.
Le projet archéologique "High Tarns" a été lancé par Grampus Heritage and Training Limited fin 2022 suite à l'identification, sur des images satellites en open source, de l'empreinte laissée par un bâtiment de grande dimension dans la région rurale de Tarns.
L'association, qui est en charge de promouvoir des projets européens liés à la Culture, au Patrimoine, à l'Archéologie et à l'Environnement, pensait avoir enfin trouvé l'emplacement d'une ferme monastique appelée Grange Farm, ayant appartenu à l'abbaye cistercienne de Holmecultram (ou abbaye de Holme) fondée en 1150.
Mais grâce à de récentes analyses, Mark Graham, l'archéologue de Grampus Heritage, a pu annoncer aux bénévoles que le site est encore plus ancien: "Cela souligne l'importance de High Tarns, où nous avons trouvé l'empreinte complète d'un bâtiment de la fin de l'Âge Viking."
Un site prometteur
En mai 2023, des membres de la Société archéologique de l'ouest de la Cumbria ont collaboré avec Grampus Heritage pour mener une étude géophysique de 2 jours sur le site. Bien que les données obtenues ne permirent pas de voir apparaître le bâtiment, quelques anomalies détectées au sud de la structure suffirent à démontrer le potentiel d'une recherche plus vaste et plus approfondie visant à mieux cerner le paysage historique de la région.
En novembre 2023, l'association a donc soumis avec succès une demande de financement au DEFRA - le département du gouvernement britannique chargé de l'Environnement et de l'Agriculture - dans le but d'entreprendre de nouvelles investigations géophysiques sur une superficie, cette fois, de 11 hectares autour de l'empreinte du bâtiment.
Avec l'autorisation des propriétaires, Neil et Irene Armstrong, l'étude réalisée au cours de l'hiver 2023/2024 livra des résultats si intéressants qu'ils donnèrent lieu à une fouille archéologique communautaire, mobilisant près d'une cinquantaine de bénévoles, du 16 juillet au 10 août 2024.
 Dix trous de poteaux
Dix trous de poteaux
C'est en combinant les images satellites, les vues aériennes et les relevés magnétométriques que l'emplacement des tranchées à creuser fut décidé.
En dépit de l'absence de résultats concernant d'éventuels vestiges, les bénévoles ont commencé par délimiter à l'aide de piquets la superficie de la structure perceptible sur les images satellites, avant d'ouvrir une première tranchée en son centre de 18,5 m de long et de 9 m de large.
À l'issue des travaux d'excavation, 10 grands trous de poteaux dont la disposition s'est avérée cohérente avec la forme de l'empreinte à la surface du sol ont été répertoriés, ce qui confirme la présence autrefois d'un grand bâtiment en bois mesurant environ 50 m de long sur 15 m de large.
Un séchoir à grains et une production de charbon de bois
La deuxième tranchée, positionnée au sud du bâtiment en bois d'après l'une des anomalies révélées par l'étude géophysique, a permis de mettre au jour sous un monticule de sable naturel un séchoir à grains, ou "séchoir à maïs", avec des marches pour y accéder, des murs revêtus de pierre, des vestiges de la voûte du foyer qui servait à chauffer les céréales et, à l'ouest, une chambre de séchage subcirculaire construite en argile et en galets.
Don O'Meara, archéobotaniste à l'institut en charge du patrimoine Historic England, a notamment identifié sur place de grandes quantités d'avoine carbonisé.
L'élément le plus ancien de la tranchée n°2 est une fosse de production de charbon de bois qui a été endommagée par la construction, par-dessus, du séchoir à maïs.
Enfin, une troisième tranchée a été ouverte pour étudier une étendue de déchets issue de travail du métal, bien qu'aucune caractéristique structurelle n'ait été identifiée.
Datée entre la fin du Xème et le début du XIème siècle
Peu d'objets datables ont été retrouvés, en grande partie à cause des siècles de travaux agricoles qui ont perturbé le site et de la nature du sol qui a empêché la conservation des matières organiques telles que le bois, l'os ou le cuir. Seuls deux petits tessons de poterie -provisoirement datés de la fin de la période médiévale- ont été découverts au-dessus du séchoir à grains qui s'est effondré après qu'il ait cessé d'être utilisé.
Malgré tout, la datation au carbone 14 des sédiments dans l'un des trous correspondant aux poteaux porteurs formant l'allée centrale du bâtiment fait remonter ce dernier à une période comprise entre 990 et 1040 de notre ère.
"La datation du bâtiment en bois de la fin du Xème / début du XIe siècle montre que la structure n'est pas du tout liée au monastère cistercien de Holme Cultram et qu'elle est bien antérieure à celui-ci", a expliqué Grampus Heritage & Training Limited dans son communiqué de presse.
Dans la tranchée n°2, la fosse de production de charbon de bois a été datée entre 990 et 1160, tandis qu'un échantillon prélevé dans la chambre de séchage situe la dernière utilisation du séchoir à grains entre 1040 et 1180.
Une halle comme au Danemark
Ne disposant d'aucun matériel culturel issu des fouilles permetant d'établir des comparaisons, Mark Graham s'est appuyé sur les datations et la documentation concernant l'héritage viking en Cumbria pour interpréter le site. Selon lui, il s'agit probablement d'une importante ferme de la fin de l'Âge Viking, semblable aux halles de la même époque au Danemark qui appartenaient à des personnes de haut rang.
Il existe dans cette partie du nord-ouest de l'Angleterre des sépultures typiques de la culture anglo-scandinave appelées "hogbacks", de nombreuses sculptures dans les églises les plus anciennes, ainsi qu'un dialecte et des toponymes d'origine scandinave. Le nom-même de la région de Tarns vient du vieux norrois "tiorn" qui signifie lac, et "tarn" est un mot couramment utilisé dans cette partie du pays pour désigner un lac ou un étang.
"Bien que la forte influence culturelle de la Scandinavie à l'époque viking en Cumbria ne fasse aucun doute, l'absence de bâtiments de cette période dans les archives archéologiques a souvent été attribuée à la probabilité que des bâtiments ultérieurs aient été construits au-dessus des sites de peuplement", souligne l'archéologue.
Une lacune désormais comblée qui rend cette découverte encore plus remarquable. "Comme si cela n'était pas assez passionnant, il s'agit du plus grand bâtiment de l'époque viking à avoir été découvert et fouillé en Grande-Bretagne", conclut-il en ajoutant qu'un rapport complet sur les fouilles sera publié "en temps voulu".
- Sources: www.grampusheritage.co.uk, www.heritagedaily.com, www.bbc.com (traduction et synthèse / Kernelyd)
viking archéologie Angleterre halle Cumbria ferme
Ajouter un commentaire